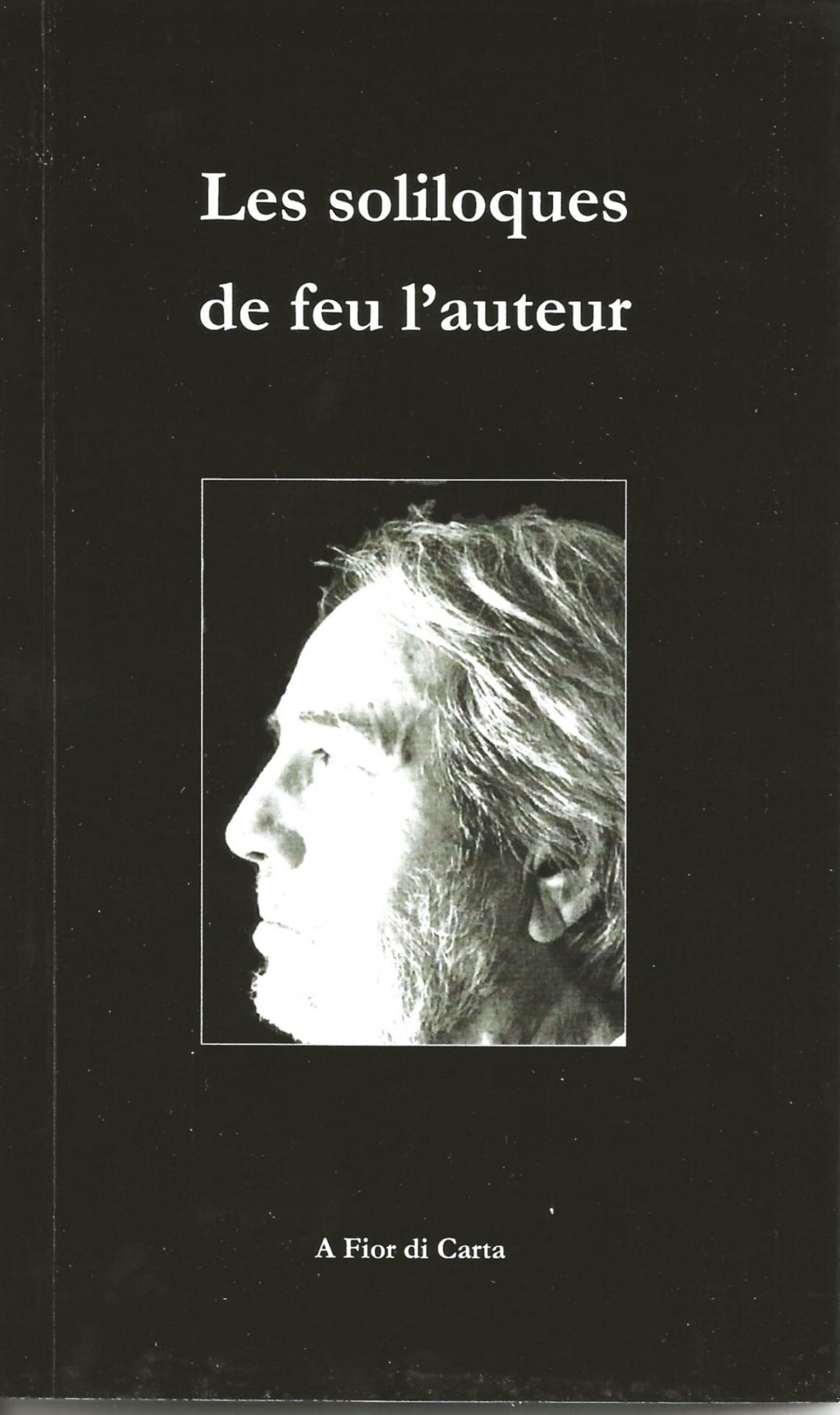Pour écrire, je me suis installé dans cette pièce, au rez-de-chaussée. Je ne manque pas de signaler à mes rares visiteurs que je suis le seul au village à habiter une maison construite de mes mains. On s’intéresse parfois à mes livres, mais le travail de « muratore » a toujours eu pour moi beaucoup plus d’importance. Il suppose une débauche d’énergie dont on s’étonne soi-même une fois l’œuvre achevée. Que pèse un volume de papier égaré au fond d’une bibliothèque en comparaison de la haute muraille retenant un jardin suspendu où l’on viendra, longtemps, s’émerveiller de la beauté du monde ?
J’ai toujours préféré l’appareillage des murs à l’assemblage des mots. Le corps s’y épuise, mais l’âme y gagne en clarté. Les pierres sont fidèles aux mains qui les recueillent, les transportent, les façon-nent et les accumulent. Elles portent à jamais, comme autant de caresses capti-ves, la trace des gestes infinis qui les ont mises à jour sur les murs, les murailles, les tours et les remparts. Elles témoignent de la matérialité compacte du monde d’ici-bas. Les mots, par contre, se dérobent, obligent à la traque, à l’affût patient, à d’exténuants parcours dans la sphère évanescente où logent les pensées. Et quand, par l’écriture, un mot s’immo-bilise, c’est qu’il est mort. Dans le tourbillon prodigieux des paroles, un instant de vie s’achève et le silence s’installe sur la page couverte de petits corps calcinés.
Avec l’âge, j’ai abandonné le travail consolant des pierres pour le labeur funèbre des écritures et je me suis installé là, à trois cents mètres d’altitude, face à la mer immense qui vient mourir dans la baie étroite où les collines d’Imiza se resserrent.
L’écriture est un effort désespéré pour retenir ce qui a vocation à disparaître dans la lenteur minérale ou la fugacité du vivant. J’ai conscience qu’on recherche le temps perdu parce que c’est perdu d’avance, mais c’est aussi ce qui donne un sens à la dignité humaine.
Écrire, c’est écrire sa propre mort. C’est renvoyer aux dieux hypothétiques l’image de leur imperfection ou de leur monstruosité. Les histoires n’ont de sens que par cet effet de miroir. Les personnages innombrables qui les peuplent sont aussi virtuels dans la brièveté romanes-que que les générations humaines dans l’accomplissement de leur destin.
Celui qui écrit ramasse le monde, amenuise l’espace, compacte le temps et préfigure la mémoire qui se dévide aux approches de la fin. Les jours et les nuits alternent avec la fulgurance de l’éclair. Les heures innombrables clignotent et se réduisent à l’impermanence de l’instant. Les souvenirs s’évadent qu’une armée de mots hérissés sur les pages essaie en vain de contenir.
Je peux dire l’ombre et je peux dire la lumière, mais je ne peux faire ni l’une ni l’autre.